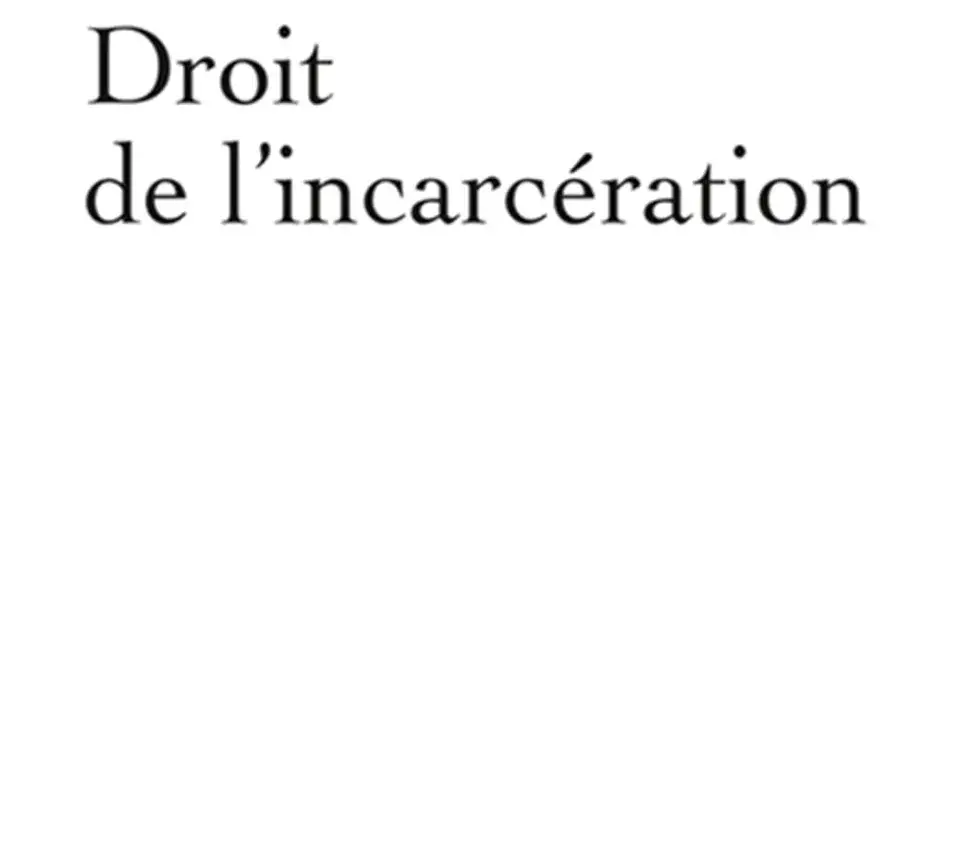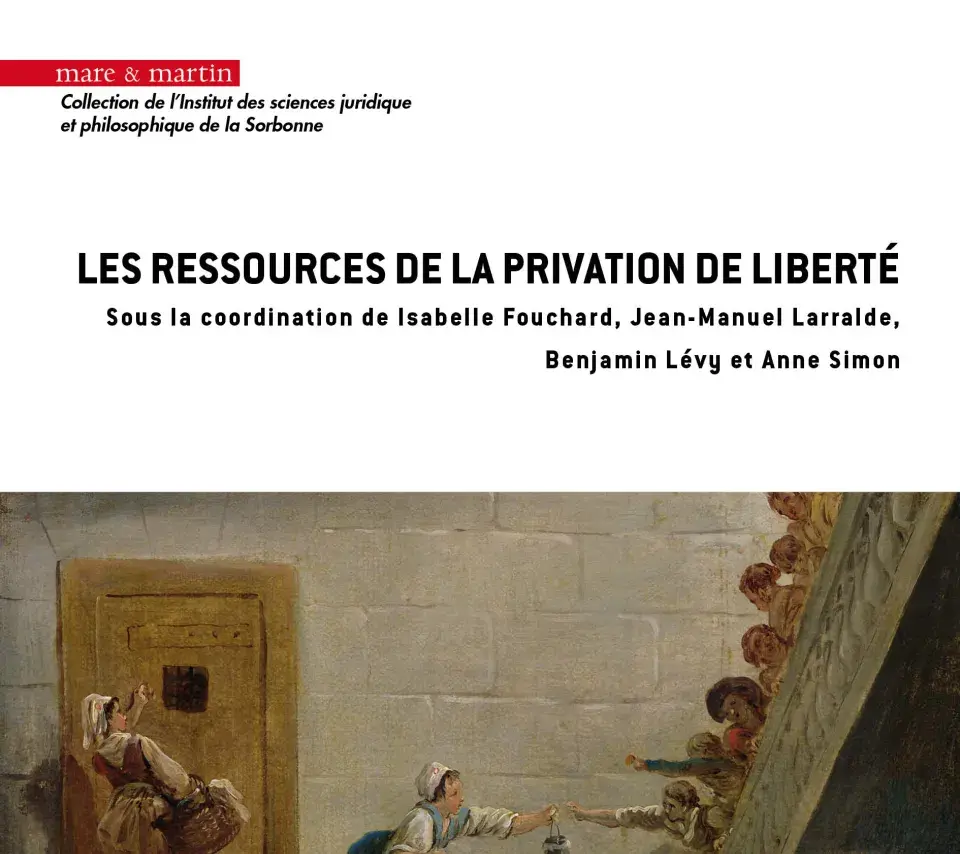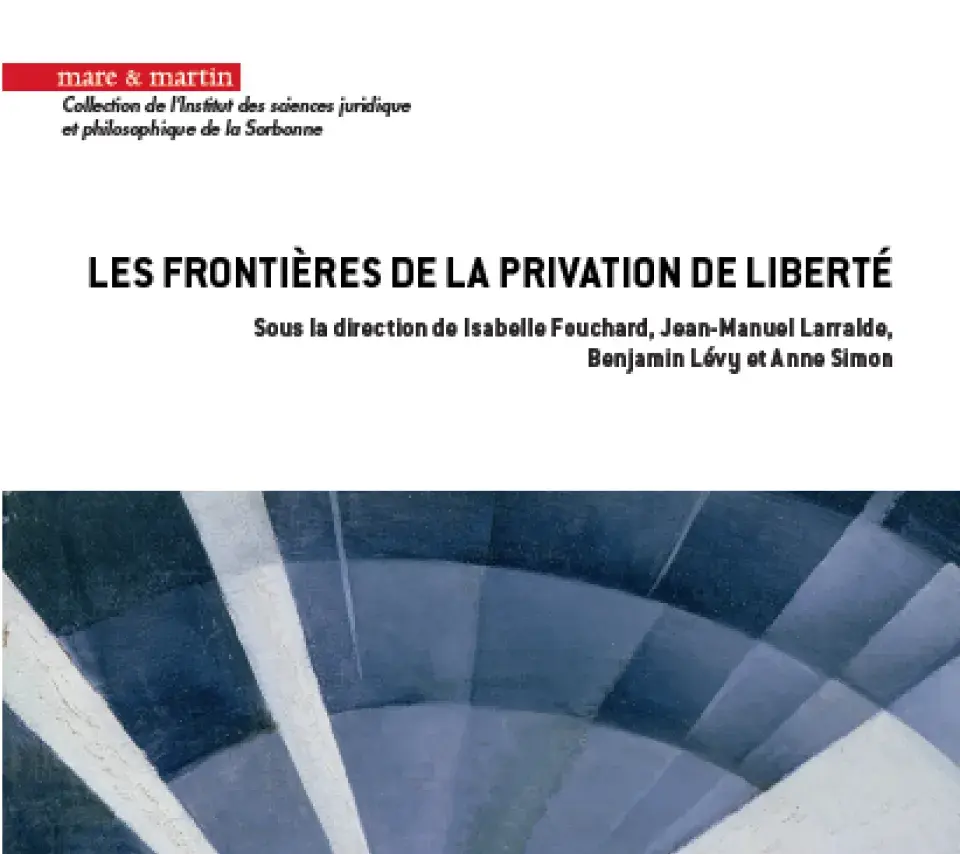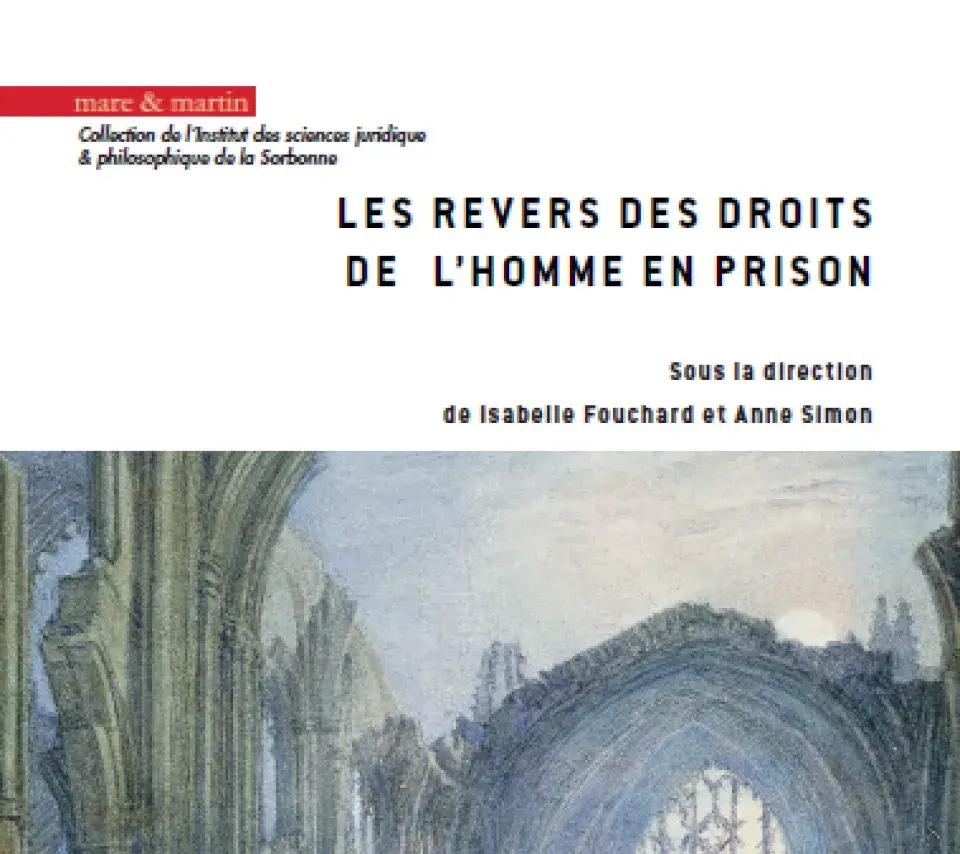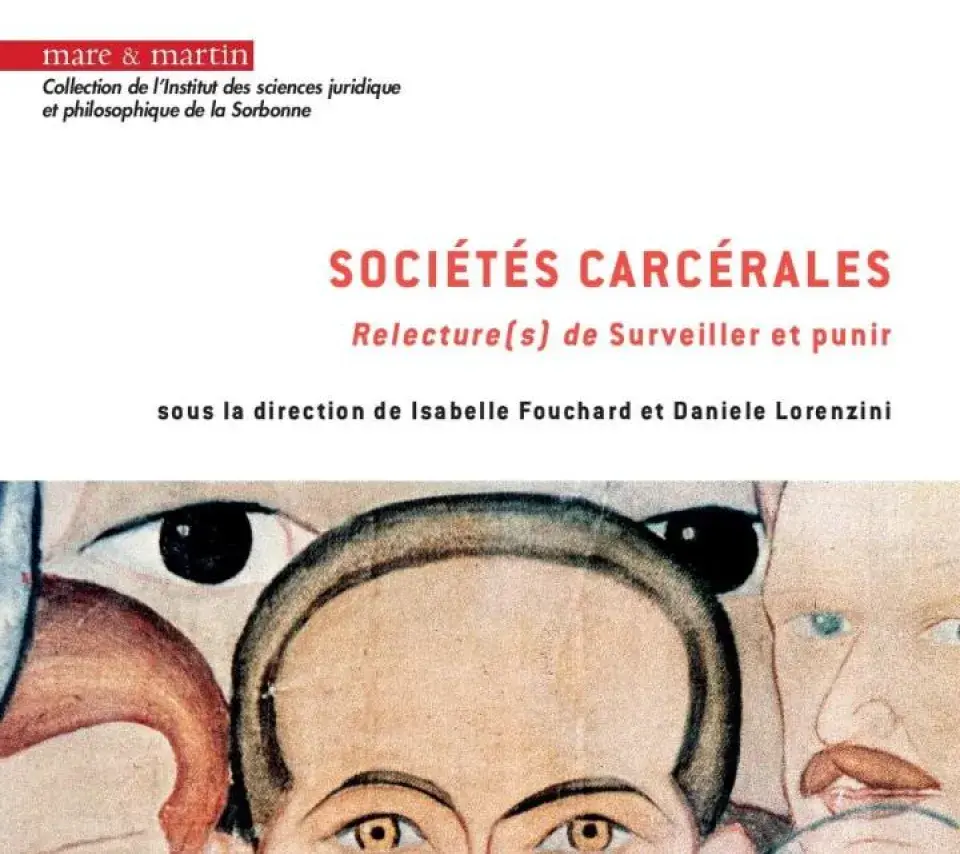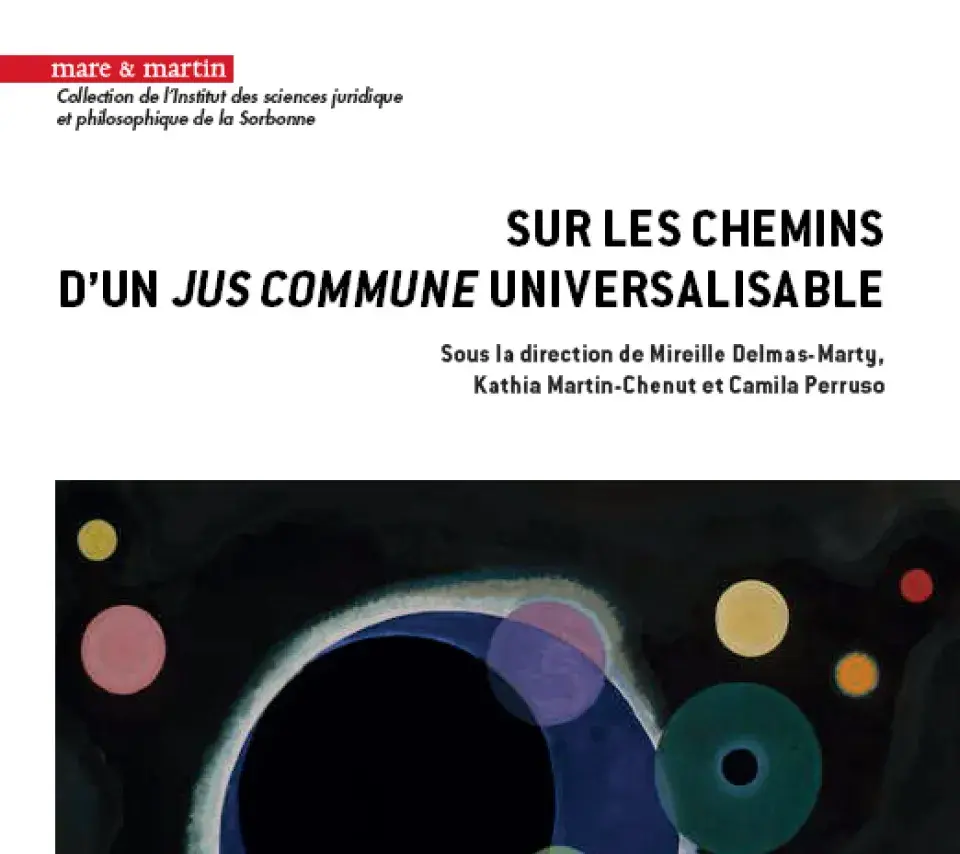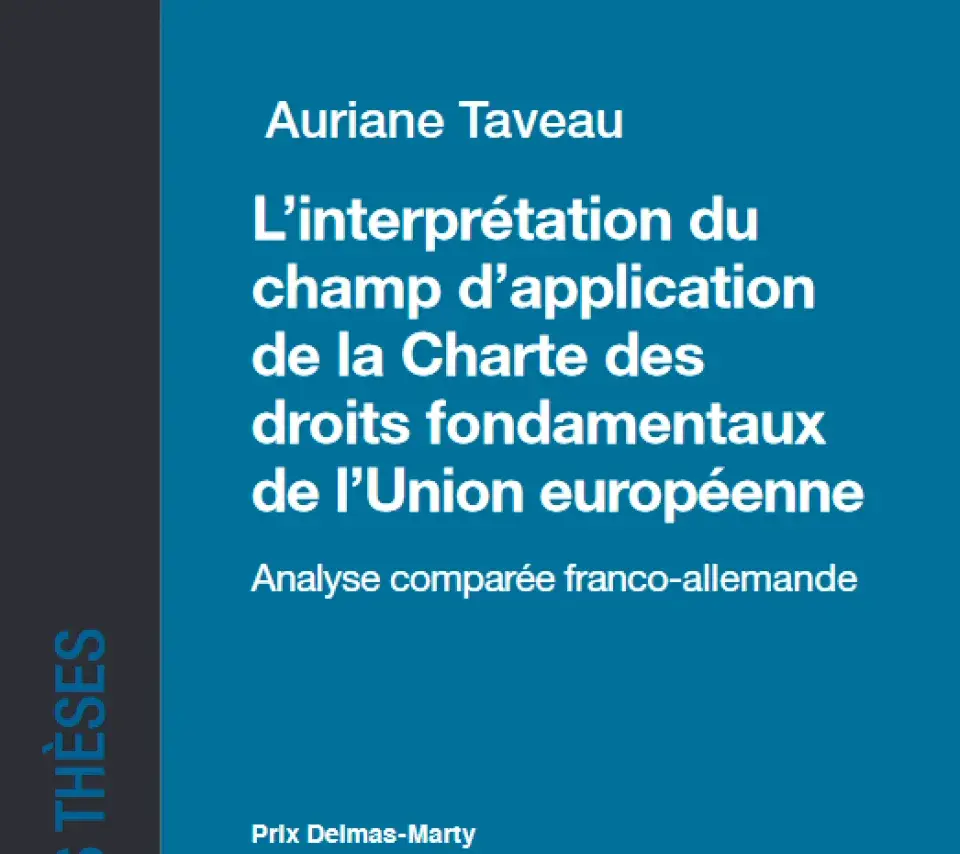Centre de droit comparé et internationalisation du droit
-
Présentation
Le centre de droit comparé et internationalisation du droit a vocation à prolonger la tradition et les domaines de recherche de l’UMR de droit comparé de Paris, créée par Mireille Delmas-Marty en 1997, et devenue l’ISJPS en 2015. La démarche comparative y est dès lors entendue au sens large : à la comparaison horizontale entre droits nationaux, espaces régionaux ou branches du droit international, s’ajoute la dimension verticale des interactions entre les droits nationaux, les droits régionaux et le droit international. Une telle démarche comparative contribue au renouvellement de la réflexion sur l'évolution des espaces normatifs en tenant compte de leur porosité.
Privilégiant une approche transversale de la normativité, ses travaux portent sur des domaines variés, parmi lesquels : droits humains, justice pénale internationale, champ pénitentiaire, expertise culturelle, méthodes et usages du droit comparé, environnement et responsabilités. Les recherches menées s’inscrivent dans l’espace global comme dans des espaces plus spécifiques – Amérique latine, études franco-allemandes – avec, en filigrane, l’utopie d’un droit commun.
Mots clés : Droit comparé | Droit régional | Droit international | Droits humains | Droit commun | Droit pénitentiaire | Droit franco-allemand | Méthodes de droit comparé
-
Équipe
Responsables :
DIALLO Aliou
KLIPFEL Coralie
LÜER Stefanie
MACHADO SUCAR Samara
PERRUSO Camila
ROTA Marie
SUASSUNA Larissa
TAVEAU Auriane
-
Expertises et travaux de recherche
-
Droits de l’homme et droit pénitentiaire
Cette thématique vise à développer l’étude transversale des dynamiques normatives qui animent le champ du droit pénitentiaire sous l’effet des exigences croissantes du respect des droits de l’homme en milieu carcéral. Ces exigences, qui découlent tout à la fois du droit international, du droit européen et du droit national, imposent des adaptations de la norme pénitentiaire d’un point de vue qualitatif – effectivité et justiciabilité des droits fondamentaux des détenus – et quantitatif – au regard non seulement du "noyau dur" des droits attachés à la dignité humaine mais également de certains droits civils, politiques ou socio-économiques.
Travaux de recherche
Lancée en septembre 2015 avec le projet Internormativités dans le champ pénitentiaire, financé par le Conseil scientifique de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (appel à projets 2015-2017), cette thématique a donné lieu à de multiples collaborations avec des acteurs de la société civile tels que le European Prison Litigation Network ou l’Observatoire international des prisons – Section française.
Elle s’est poursuivie par une recherche pluridisciplinaire (droit, psychologie, sociologie) de deux ans financée par l’IERDJ : La délinquance carcérale au prisme des peines internes dont le rapport final est disponible en ligne (mars 2024).Dans ce cadre, alternativement, tous les deux ans, sont organisés :
- le Colloque Jeunes Chercheur(e)s sur la privation de liberté, conçu comme espace d’expression et de visibilisation des jeunes chercheur(e)s (juristes, politistes, historiens, sociologues, linguistes, psychologues, etc.), tant par leur participation au colloque qu’à travers la publication des interventions dans un ouvrage collectif aux éditions Mare et Martin.
- 4e édition : « Les sens de la privation de liberté », Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 15 et 16 mars 2018.
- 5e édition : « Les frontières de la privation de liberté », Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 12 et 13 mars 2020.
- 6e édition : « Les ressources de la privation de liberté », Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 17 et 18 mars 2022.
- 7e édition : « Les populations de la privation de liberté », Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 15 et 16 mars 2024.
- 8e édition : voir l'appel à communications pour "Les temporalités de la privation de liberté" (Paris, 12 et 13 mars 2026).
- l’Université d’été sur le contrôle des lieux de privation de liberté
Organisée en partenariat avec l’Université d’Artois (Prof. Anne Simon) et l’Université libre de Bruxelles (Damien Scalia), cette formation continue d’une semaine est destinée notamment aux membres des mécanismes nationaux de prévention de la torture, magistrats, avocats, membres des organisations non gouvernementales actif.ve.s dans le domaine et aux étudiant.e.s désireux.se.s de se perfectionner en la matière. Elle vise à la fois à fournir une formation théorique pluridisciplinaire en matière de détention et une formation pratique de contrôle et de visite des lieux de privation de liberté.- L’édition 2021 a eu lieu à Paris du 23 au 27 août 2021.
- L’édition 2023 a eu lieu à l’Université Libre de Bruxelles du 28 au 1er septembre 2023.
- La prochaine est prévue à Douai, du 25 au 29 août 2025, dans les locaux de l’Université d’Artois, avec une visite prévue de la maison d’arrêt de Douai.
Équipe
Responsables :
Membres :
Ariane Amado, docteure en droit pénal comparé, chargée d'études au laboratoire de Recherche et d'innovation de la Direction de l’administration pénitentiaire, chercheure associée à l'ISJPS
Corentin Durand, docteur en sociologie, Centre d’études des mouvements sociaux/Centre Maurice Halbwachs, École des hautes études en sciences sociales
Jenny Frinchaboy, maître de conférences à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Institut de recherche juridique de la Sorbonne (IRJS)
Amal Hachet, maître de Conférences (HDR) en psychopathologie clinique et criminologique, université de Poitiers
Marco Isaia, psychologue clinicien, docteur en psychologie de l’université Paris Diderot et chargé d’enseignement à l’université de Poitiers
Camille Lancelevée, docteure en sociologie de l’EHESS, chargée de recherches à la Fédération de recherches en psychiatrie et santé mentale des Hauts-de-France (F2RSM-Psy) en charge de l’organisation de l’étude SPCS (santé mentale en population carcérale sortante)
Xavier de Larminat, maître de conférences en science politique, université de Rouen Normandie, laboratoire CUREJ (Pôle sociologie)
Benjamin Levy, psychologue clinicien, chargé d’enseignements à l’École des psychologues praticiens (Paris) et à l’université libre de Bruxelles, docteur en psychopathologie et psychanalyse de l’université Paris Diderot.
Adrien Maret, doctorant en science politique, chargé d’enseignement, Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales (CESDIP), université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ)
Caroline Touraut, docteur en sociologie, chargée d’études à la DAP, cheffe de section du pôle innovations sociales (EX4), chercheuse associée au CESDIP
Bérénice Vannesson, psychologue clinicienne, GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, SMPR de la maison d’arrêt de Paris La Santé
Laure Westphal, docteur en psychologie, psychologue clinicienne au sein du pôle de Psychiatrie et addictions « La Terrasse » (GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences) et chargée d’enseignement à Sciences Po Paris
Publications choisies
- le Colloque Jeunes Chercheur(e)s sur la privation de liberté, conçu comme espace d’expression et de visibilisation des jeunes chercheur(e)s (juristes, politistes, historiens, sociologues, linguistes, psychologues, etc.), tant par leur participation au colloque qu’à travers la publication des interventions dans un ouvrage collectif aux éditions Mare et Martin.
-
Internormativités et droit commun
Face aux défis globaux et bouleversements géopolitiques d’ampleur auxquels l’humanité est confrontée, entre exacerbation des interdépendances et réactions de replis identitaires, que peut le droit aujourd’hui? Que reste-t-il des valeurs et des objectifs communs portées par la Charte des Nations Unies ou la Charte internationale des droits de l’Homme telle la paix ou le respect universel des droits fondamentaux ? Les développements récents condamnent-ils définitivement l’idée même d’un droit commun ou au contraire viennent réaffirmer son impérieuse nécessité ? De multiples questionnements perdurent : a-t-on besoin d’un droit commun ? A-t-il déjà existé, même sous la forme de fragments ? À quelle condition serait-il véritablement commun ? Quels en sont les acteurs, les enjeux, les risques et les bénéfices ? Quels seraient les domaines du droit qui résisteraient à un tel processus d’harmonisation ? Quelles techniques juridiques favoriseraient l’émergence d’un droit commun ou au contraire l’empêcheraient ? C’est notamment à partir de ces premières pistes que plusieurs projets, articulés autour de l’idée d’un droit commun, se développent au sein du centre de droit comparé et internationalisation du droit.
Équipe
Responsables :
Publications choisies
-
Droit comparé et expertise culturelle
La thématique « Droit comparé et expertise culturelle » met en avant l’importance cruciale de l’expertise culturelle et son impact sur les méthodes de la comparaison. Cette approche vise à repenser les méthodologies du droit comparé afin d’y intégrer des perspectives interdisciplinaires et de sciences partagées, tout en valorisant les savoirs souvent marginalisés, notamment ceux des peuples autochtones, des paysans, et des communautés locales. Les sciences partagées, au cœur de cette démarche, placent les bénéficiaires de l’expertise culturelle et les usagers du droit au centre de la réflexion. Elles reposent sur une collaboration active entre chercheurs, praticiens et acteurs directement concernés, afin de coconstruire des savoirs et des solutions juridiques qui reflètent leurs expériences, leurs besoins et leurs contextes.
L’expertise culturelle est mobilisée dans des domaines variés, tels que la migration et l’asile, le droit de la famille, le droit pénal, le droit international, ainsi que des champs émergents comme le patrimoine culturel, les droits bio-culturels et les droits des paysans. Ces champs traduisent des enjeux globaux où les normes juridiques croisent les réalités locales et où les sciences partagées permettent de rendre visibles les perspectives des communautés les plus souvent ignorées. Dans le cadre des droits bio-culturels, par exemple, il s’agit de reconnaître les liens étroits entre biodiversité, pratiques culturelles et identité collective, en mettant en avant les savoirs ancestraux des communautés locales et autochtones. De même, les droits des paysans, qui incluent des questions de souveraineté alimentaire, de préservation des écosystèmes et de protection des savoirs traditionnels, ne peuvent être pleinement appréhendés sans l’apport direct de ceux qui les vivent au quotidien.
En favorisant une approche collaborative et participative, cette thématique promeut des solutions juridiques adaptées et inclusives. Par exemple, dans le domaine de la migration et de l’asile, les sciences partagées permettent de mieux comprendre les récits des demandeurs en les inscrivant dans leurs contextes socioculturels spécifiques. En droit de la famille, elles offrent une voie pour réconcilier les normes universelles avec des conceptions locales des relations familiales. Dans les arbitrages commerciaux internationaux, la prise en compte des perspectives culturelles des parties concernées contribue à renforcer la légitimité et l’efficacité des décisions. Ces démarches co-construites permettent également de répondre aux défis environnementaux en intégrant les connaissances des peuples autochtones et des communautés locales dans la gestion des ressources naturelles et la protection des territoires.
Cette thématique met également un point d’honneur à diversifier les dialogues juridiques et à élargir les perspectives comparatives en collaborant avec des collègues issus de régions et de traditions juridiques souvent sous-représentées. L’intégration des savoirs provenant d’Afrique, d’Asie du Sud et du Sud-Est, d’Amérique latine, des îles du Pacifique, et des peuples autochtones est indispensable pour construire une vision véritablement globale et inclusive du droit. Cette ouverture enrichit les méthodologies comparatives et renforce la pertinence des solutions élaborées face aux défis globaux, en s’assurant qu’elles reflètent une diversité de voix et de réalités.
En adoptant une approche qui articule expertise culturelle, sciences partagées et dialogue global, cette thématique contribue à la construction d’un droit comparé inclusif, équitable et respectueux des diversités. Cette démarche, qui place les voix des bénéficiaires et des usagers au centre, offre des perspectives innovantes pour concevoir des politiques publiques, résoudre les conflits, préserver les patrimoines culturels et naturels, et répondre aux défis environnementaux et sociaux du XXIe siècle.Cela a débouché sur Cultural Expertise, Cultural Heritage and International Commercial Arbitration.
La Fondation CULTEXP, sous l'égide la Fondation CNRS, a pour mission de rendre l’expertise culturelle accessible, structurée et fiable, pour une justice plus inclusive.
Voir la présentation de l'expertise culturelle et de la base de données CULTEXP.
Équipe
Responsable :
Livia Holden
Membres :
Aliou Diallo
Programmes de recherche
-
Droit comparé franco-allemand
Le centre de droit allemand, devenu équipe de recherche en droit comparé franco-allemand, se consacre à l'étude du droit des pays de langue allemande : Allemagne, Autriche, Suisse. Les recherches ont d'abord pour objets les thèmes suivants de droit public : théorie générale des droits fondamentaux, rapports entre le droit constitutionnel national et l'Europe, droits procéduraux des citoyens devant l'administration et le juge administratif, droit public des affaires.
Plusieurs formations en droit allemand s'appuient sur son équipe de recherche : le master en droits français et allemand, le master 2 Juriste international, le master européen de gouvernance et d'administration (MEGA). Un séminaire de droit allemand est organisé mensuellement. En lien avec l'École doctorale de droit de la Sorbonne, il participe à l'organisation du Collège doctoral franco-allemand en droit public comparé européen de l'université franco-allemande.
S'abonner à la liste de diffusion en droit comparé franco-allemand
Équipe
Responsable : David Capitant
Membres :
Stefanie Lüer
Auriane Taveau
Publications choisies
Méthodes du droit comparé : les rencontres annuelles
-
Droits de l’homme et droit pénitentiaire