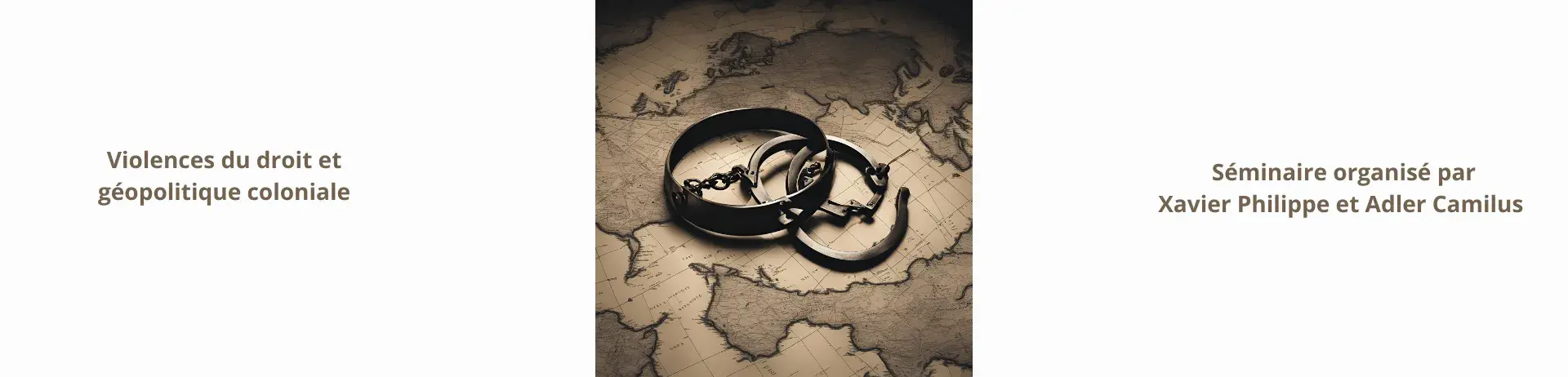
Violences du droit et géopolitique coloniale
Présentation
L’histoire des pensées critiques est celle d’une rationalité saisie soit comme sphère émancipatrice, soit comme sphère assujettissante ou les deux, soit comme critique d’un imaginaire du monde qui se présente faussement comme scène originaire de toute subjectivation égalitaire et de l’universel se déployant progressivement dans l’Histoire. La déconstruction de celle-ci a été entreprise à plusieurs reprises (Théorie critique, critique postmoderne, études postcoloniales, décoloniales). Dans chacune de ces configurations théoriques, le droit n’est pas pensé de la même manière. Il ne rencontre pas non plus les différences construites de la même manière. Mais les expériences de violence (patriarcale, raciale et impériale) portées par le droit tendent à démontrer les modalités par lesquelles le droit se réalise par auto-perversion quand il codifie le patriarcat, le racisme (le Code noir), l’antisémitisme et la destruction des mondes élevés en objet de prise géopolitique (Conquête, colonisation, traites, esclavage, occupation, la rançon de la révolution haïtienne de 1804). Dans chacun de ces exemples d’auto-perversion du droit, il y a une rencontre avec les figures des différence face auxquelles l’universalité du droit devient celle d’une raison patriarcale, raciale et impériale. La colonialité du droit n’est qu’un exemple d’auto-perversion du droit dans laquelle le droit se réalise par auto-renoncement à son universalité. La géopolitique coloniale (fondée sur l’enchevêtrement des imaginaires impérial, patriarcal, racial et le capital) dont Le nomos de la Terre de Carl Schmitt reste l’exemple le plus radical dit aussi quelque chose de symptomatique du droit. Elle triomphe là où la puissance du droit souverain n’est plus alimentée par le conatus de certaines cités tombant nécessairement « sous le droit d’autrui ». (Spinoza, TP) Si elle se manifeste comme le droit de « ravager les pays conquis » (Tocqueville) jusqu’à provoquer la disparition des peuples dans l’histoire (Haïti), elle peut prendre aussi la forme d’un soft power.
Ce séminaire propose une réactualisation d’une critique radicale du droit où les scènes de violences du droit et la géopolitique coloniale deviennent inséparables. Son originalité est de s’efforcer de maintenir en même temps la possibilité d’une pensée immanente du droit qui ne reproduit pas la possibilité de réification des rapports de domination, d’exploitation et d’injustice. La réconciliation d’une société avec le droit se trouve-telle dans cette immanence du droit sans que ce dernier puisse être la sphère de justification de profanation du monde et des rapports sociaux de domination, c’est-à-dire sans renoncer à l’égalité et l’émancipation ?
Programme
Pathologies sociales postcoloniales et justice transitionnelle
Mardi 13 mai 2025, 18h-19h30, centre Panthéon, salle 216
L’universel et sa dette (la rançon de 1804) : l’injustice du droit
Juin, date et lieu à définir
Faire et le défaire le droit : Les pratico-poïétiques et l’immanence du droit
Juillet, date et lieu à définir
Séminaire mensuel de recherche organisé par Xavier Philippe et Adler Camilus (ISJPS, centre Sorbonne constitutions & libertés).
Séances précédentes
- Mardi 18 février 2025
Visionner l'enregistrement de la séance du 18 février 2025
Violences du droit et Violence du Père
Code secret : iB1&u*Ym
- Mardi 18 mars 2025
Le Code noir et le droit souverain : l’esclave et le sujet de droit moderne?
- Mardi 22 avril 2025
Droit, colonialité et géopolitique coloniale
Informations pratiques
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, centre Panthéon
12 place du Panthéon, 75005 Paris
Salle 216
Inscription gratuite mais obligatoire : à l'issue de l'inscription, un message de confirmation vous sera envoyé avec un billet PDF en pièce jointe. Ce billet, accompagné d'un document d'identité, est indispensable aux personnes extérieures à l'université Paris Panthéon-Sorbonne pour accéder à l'événement.